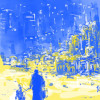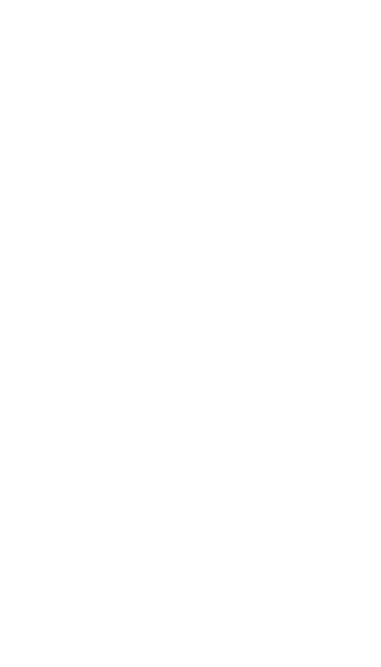BioGraphie
Janos ROZSAS
Janos Rozsas naît en août 1926 à Budapest dans une famille ouvrière. Dès son plus jeune âge, il a la passion des livres et un talent pour les langues, mais il doit interrompre l’école à 14 ans pour aider financièrement sa famille.
Il est envoyé au front contre l’armée Rouge à 18 ans et il est très vite fait prisonnier et condamné pour haute trahison à 10 ans de travaux forcés et à l’exil à vie en URSS. Il ne comprend pas sa condamnation mais se dit soulagé car il pensait être exécuté. Il est d’abord envoyé à Odessa, puis vers les camps ukrainiens de Nikolaïev et Kherson, où il apprend le russe en quelques mois. En 1946, il part pour un camp de l’Oural du Nord où il survit dans des conditions de froid et de faim atroces, ou plutôt, dira-t-il, où il vit «en essayant de construire un petit monde autour de moi, grâce aux livres. Il fallait rêver, s’élever au-dessus de la réalité. Je passais mes nuits à lire en cachette et j’enchaînais avec les journées de travail.» En 1949, il est envoyé au Kazakhstan, où il y rencontre Soljenitsyne avec qui il se lie d’amitié, grâce à sa passion de la littérature et de la culture russe peu commune pour un Hongrois enfermé au goulag.
En 1954, il est amnistié et rentre en Hongrie. Là, il entreprend d’écrire sur ses neuf années dans les camps, comme il avait décidé de le faire bien avant d’être libéré, s’il survivait. Il assume aussi un autre travail de longue haleine : aidé par sa connaissance du russe, il se charge d’écrire les demandes de réhabilitation de centaines de ses compagnons de goulag. Ses mémoires sont publiées à Munich en 1987 et traduites en anglais et en allemand. Malgré le froid, la faim, les humiliations et les violences, M. Rozsas dit : «Je ne regrette pas mes neuf années de goulag. Si j’avais à les refaire, je les referais. J’ai rencontré des personnes et j’ai appris des choses si intéressantes !», et il ajoute sur la Russie : «J’ai la nostalgie de ce pays que j’aime tant, c’est là où j’ai passé ma jeunesse.»
L'entretien avec Janos Rozsas a été conduit en 2009 par Anne-Marie Losonczy et David Karas.