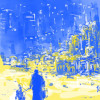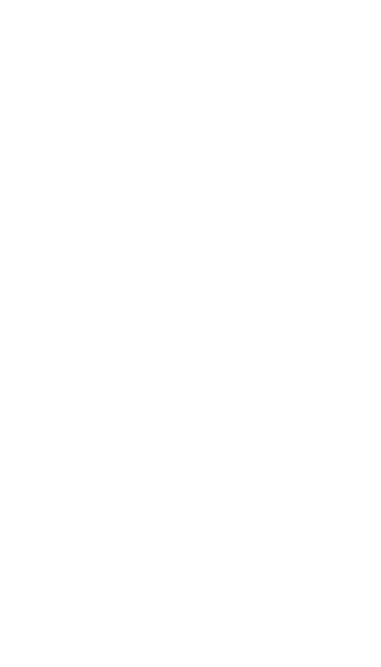Європейська пам'ять
про Гулаг
Біографії
Placid KAROLY OLOFSSON
Le père Placid Karoly Olofsson naît en décembre 1916 à Rákosszentmihály en Hongrie, d’un père professeur de lycée et peintre à ses heures et d’une mère d’origine allemande. Il grandit dans un milieu intellectuel, très chrétien, et en 1933, au sortir d’un lycée bénédictin, il fait des études de théologie et de langue et civilisation germaniques. Il obtient un doctorat et est ordonné prêtre.
Pendant la guerre, il est aumônier dans un hôpital militaire, puis enseigne dans un lycée catholique en province, ensuite à Budapest. En janvier 1946, la police politique hongroise l’arrête. Il est condamné à 10 ans de travaux forcés car sa participation, lors des élections libres en 1945, à la campagne électorale pour le parti des petits propriétaires est considérée comme un crime. Il est d’abord enfermé dans une prison de Budapest gardée par des soldats soviétiques. Assigné au nettoyage des couloirs, il peut chanter (en hongrois sans que les gardes s’en rendent compte) l’extrême-onction aux condamnés à mort.
Pendant toute sa période de captivité, il se donne comme tâche de «réveiller l’esprit» de ses compagnons prisonniers, de les réconforter, pour qu’ils «sentent la présence de Dieu» et pour qu’ils se sentent humains. Pour lui, ce n’est pas l’armée Rouge qui l’a envoyé au goulag, c’est la volonté de Dieu qui l’a soumis à cette épreuve. «Dieu a beaucoup d’humour et de sens de l’ironie», dira-t-il. Ainsi, durant toutes ces années au goulag, au prix de mille astuces, il fera toujours son «devoir» : célébrer la messe, la nuit dans la baraque, avec du jus de raisin et du pain azyme, tout comme organiser les «concours des petits plaisirs de la vie “pour que ses compagnons puissent dépasser le contexte”». Il travaille à la coupe du bois puis dans la fabrique de meubles. Un jour, il devient le peintre du camp et fait des portraits des gardes ou des prisonniers de droit commun. Il est libéré en 1955 et rentre à Budapest, où il ne peut plus exercer son sacerdoce. Il trouve du travail dans une serrurerie où il perd un doigt. Accusé de sabotage, il finit ouvrier dans la laverie d’un hôpital dont il devient le directeur, tout en dirigeant des groupes de prière clandestins.
Depuis sa retraite en 1977, il renoue progressivement ses liens avec l’Église et exerce comme prêtre encore aujourd’hui.
L'entretien avec Placid Karoly Olofsson a été conduit en 2009 par Anne-Marie Losonczy et David Karas.
-
 L'extrême-onction
L'extrême-onction

Source: Entretien réalisé en Hongrie, le 06/06/2009, par A.-M. Losonczy & David Karas.
Licence CC BY-NC-ND
ЗакритиL'extrême-onction
C’était peut-être le sixième ou le huitième jour, je balayais. Je savais déjà qu’au bout d’un des couloirs, il y avait 6 cellules de condamnés à mort. A ce moment-là, 32 condamnés à mort y attendaient leur exécution. Là, le Saint Esprit et Dieu m’ont encore fait un clin d’œil ; et m’ont poussé à chanter en hongrois ça : « un prêtre catholique fait le ménage ici. Celui qui veut faire sa sainte confession, qu’il se repente de ses pêchés et d’ici je lui donnerai l’absolution. Vous avez certainement entendu qu’il existe ce genre de choses chez les catholiques. Donc… à l’époque, l’absolution était encore donnée en latin « ego te absolvo a pecatis tuis » : je t’absous de tes pêchés. Pour ça, j’ai cherché une chanson populaire hongroise. Aujourd’hui, plus personne ne la connaît, mais à l’époque elle était connue, même les tsiganes la jouaient. « Je n’ai pas de toit, ni de houppelande»… « ego te absolvo a pecatis tuis » et je chantais, chantais l’absolution. C’est alors que j’ai compris que ce n’est pas le tribunal militaire qui m’a condamné, selon le paragraphe 58.2.8.11, non ! C’est le Bon Dieu qui m’a envoyé ici… – parce que je suis un berger des âmes, mais ça je ne pouvais pas le dire. J’aurais dû dire « je suis un ouvrier spécialisé dans l’âme… », bref. Mon devoir sera de réconforter mes codétenus. Parce que pour moi, c’était quand même plus facile : j’avais une préparation spirituelle et pas de femme, ni enfants. Mais ces jeunes gens qui ont dû abandonner leurs jeunes femmes et leurs petits enfants. Et l’Union Soviétique a réussi à nous transmettre, de main de maître, le sentiment que notre vie ne tenait qu’à un fil. Nous ne savions jamais à quel moment ils allaient nous tirer dans la nuque. Vous savez… ce n’est pas si simple et moi, j’avais une tâche et… ce n’est pas de la prétention ! Mais, vraiment, c’était l’intention du Bon Dieu. La preuve en est que je ne suis pas sorti en 1953 mais seulement en 1955… j’étais le dernier.
-
 Une messe au camp
Une messe au camp

Source: Entretien réalisé en Hongrie, le 06/06/2009, par A.-M. Losonczy & David Karas.
Licence CC BY-NC-ND
ЗакритиUne messe au camp
La première semaine, lorsque nous étions déjà là-bas au camp, je me suis rendu compte que les ressortissants soviétiques recevaient des colis, un colis tous les mois et nous, on ne recevait jamais de colis, on ne nous envoyait rien depuis la Hongrie, mais ceux-là, ils en recevaient. Et mes codétenus lithuaniens et polonais, qui avaient la nationalité soviétique, recevaient toujours une sorte d’hostie de cette taille, peut-être un peu plus grande, dans leur colis. Un peu verte, un peu jaune, un peu rose… et je leur ai demandé : « c’est quoi ça ? » « Ah ! Chez nous, c’est une tradition populaire. C’est le « oplatka », c’est un mot polonais… c’est une habitude populaire, un symbole de l’unité et de l’amour familiaux. Au pied de l’arbre de Noël, le chef de famille donne cette hostie aux autres membres de la famille, ils en prennent un bout et chacun garde le sien. Ils envoyaient ça aux détenus pour qu’ils sentent que leurs familles continuent à les aimer. Il faut ajouter qu’on peut encore s’en procurer comme des décorations de Noël, j’en ai reçu cette année encore de Pologne. Sur l’emballage, il était marqué « oplatka ». Ainsi, J’avais déjà les hosties, mais pas encore de vin… Accrochez-vous ! Le Bon Dieu envoie un Jésuite italien, Pater Leone, il vit actuellement au Canada. Quand j’ai appris qu’il était jésuite, je l’ai abordé, non pas pour me plaindre - car, rappelez-vous, on ne doit pas se plaindre - mais pour lui dire : « j’ai déjà des hosties, mais pas de vin, donc je ne peux pas célébrer la messe ». Ce à quoi il répond : « pourquoi ? vous n’avez pas entendu parler en Hongrie d’un décret de Pie XII de 1942 qui autorise dans des circonstances exceptionnelles de remplacer le vin par du jus de raisin ? ». Mon Dieu ! Mes codétenus caucasiens, ressortissants soviétiques, Tadjiks, Azerbaïdjanais, Arméniens, Géorgiens… recevaient dans leurs colis des grappes de raisins car pour eux, le raisin est la base de leur alimentation et un symbole national : un raisin caucasien est plus grand qu’une prune chez nous. Je les ai exprimés et avec les premières gouttes de ce jus de raisin, j’ai pu célébrer la messe. La nuit, sur les châlits supérieurs, à plat ventre, nus, chassant les punaises… mais je pouvais célébrer la messe et le matin, je pouvais donner la communion à mes compagnons. Et j’ajoute pour vous que dans deux lager différents, des compagnons calvinistes m’ont dit: « parfois, nous vous envions, les papistes, parce qu’à la fin de votre confession, vous entendez le pardon de Dieu. Nous, nous avons aussi des liturgies de repentance mais nous ne pouvons qu’espérer Son pardon ». Et bien moi, je leur ai donné l’absolution et je leur ai même donné la communion ; en fin de compte, ils ont la cène, n’est-ce pas… Mais ce que ça a pu représenter pour nous dans cet enfer ! Je ne peux pas l’exprimer même en parlant à l’infini. C’était une telle bénédiction de Dieu ! C’est grâce à ça que nous avons pu survivre. Je vais encore vous dire quelque chose : j’avais de moins en moins d’ « oplatkas ». Je célébrais la messe avec des morceaux de plus en plus petits et plus de Polonais, ni de Lithuaniens autour de moi… si mon stock d’ « oplatkas » s’épuisaient : plus de Sainte Messe ! Je n’avais plus beaucoup de codétenus hongrois avec moi non plus… il n’y avait plus beaucoup de communion à faire. Mais un matin, j’ai observé qu’un de mes codétenus, un Moscovite, n’a pas accepté le bout de pain qui accompagnait la soupe au chou ; le lendemain non plus. « Il est fou », me suis-je dit. Le surlendemain, il a aussi refusé. Je ne l’ai pas supporté. Je lui ai dit : « Mon pote. Tu veux te suicider ? La kacha et la soupe au chou ne nous suffisent pas. Le pain, c’est la survie ! » « Non ! » dit-il. « Je ne veux pas me suicider mais je suis Juif croyant et 6 semaines avant le Yom Kippour, nous ne mangeons plus de pain ordinaire. Je reçois du pain azyme de la communauté israélite de Moscou et c’est ce que je mange ». Mes neurones ont commencé à s’activer. Lors de la Cène, Jésus… la Cène célèbre la libération de l’Egypte. Lors de la fuite, le temps pour la fermentation du pain a manqué. Ainsi, cette fête s’appelait celle du pain non fermenté… c’est écrit dans la Bible ! Si le pain azyme convenait à Notre Seigneur lors de la Cène, je ne pouvais pas faire la fine bouche. Donc, je lui dis : « Mon pote. Tu ne pourrais pas écrire à ta communauté ? Moi aussi, j’aurais besoin d’un peu de pain azyme. » Là, je ne dirai plus qu’une phrase : un moine professeur bénédictin hongrois, prisonnier politique dans le goulag soviétique, y célèbre la messe avec du pain azyme reçu de la communauté israélite de Moscou. J’ai célébrer la messe pendant six mois avec les deux kilos de pain azyme que j’ai reçu de Moscou ! Aurions-nous pu inventer ça ? Seul le Bon Dieu a pu l’inventer et ça, mes codétenus l’ont senti, l’ont vécu jusqu’au bout. Donc, aucun codétenu n’est revenu sans foi du lager… Sans aucun doute !
-
 L'économie soviétique
L'économie soviétique

Source: Entretien réalisé en Hongrie, le 06/06/2009, par A.-M. Losonczy & David Karas.
Licence CC BY-NC-ND
ЗакритиL'économie soviétique
Une fois, j’ai demandé au responsable de l’approvisionnement : « apportez-moi dans votre poche un œuf. Ca fait huit ans que je n’en ai pas mangé ». Il m’a dit : « d’où veux-tu que je t’en apporte ? Chez nous, il n’y a pas de volaille »… L’économie soviétique est stupide ! Dans les forêts de boulot pluri centenaires, le sol était tellement riche que la volaille aurait pu s’alimenter uniquement de la végétation. Oui. Mais la norme de réquisition de 57 œufs par poule. C’était tellement complément qu’ils préféraient cesser l’élevage de volaille. Je suis ignorant de ce point de vue parce que je suis budapestois mais dans notre lager, aux 1400 prisonniers s’ajoutaient au moins 1000 personnes entre les gardiens, le personnel et leurs familles. C’était tout un village. Il n’y avaient que six cochons. Ceux qui étaient de la campagne s’étonnaient : « comment font-ils pour n’avoir que six cochons ? ». 600 cochons, c’est un bon village. 60 cochons, c’est un village misérable. Mais six cochons… là aussi, le niveau de réquisition était tel qu’ils ne voulaient tout simplement pas s’exposer à ne pas remplir les normes : ils s’en occupaient donc pas… une stupidité sans nom… L’Union Soviétique, le pays le plus riche du monde ! Mais la stupidité du système était encore plus grande…
-
 La première règle de survie
La première règle de survie

Source: Entretien réalisé en Hongrie, le 06/06/2009, par A.-M. Losonczy & David Karas.
Licence CC BY-NC-ND
ЗакритиLa première règle de survie
La première règle de la survie... on ne doit pas dramatiser la souffrance parce que ça affaiblit. Or, pour supporter la souffrance, nous avons besoin de toute notre énergie. Concrètement, nous y parvenions en ne laissant aucun de nos compagnons se plaindre. Quand quelqu’un râlait ou exprimait un mécontentement ou une tristesse : « parle-nous de ton métier ! ». Tout le monde sait parler de son métier. Pendant ces 10 ans, j’ai découvert tant de métiers… élevage de dindes, apiculture, mines, reliure de livres et compagnie. On ne permettait pas la plainte. Dans la pratique, nous essayions d’arranger ça par le jeu... Autre chose : en 1953, j’avais comme codétenu le directeur général de l’Office des Statistiques de Moscou. C’est de lui que j’ai entendu qu’il existe trois sortes de Soviétiques : ceux qui ont été en prison, ceux qui sont en prison, ceux qui seront en prison. C’est le directeur de l’Office des Statistiques de Moscou qui m’a dit ça ! Nous interprétions ça dans ce sens : « nom d’un chien ! Des trois millions et demi de prisonniers, il y aura des centaines, des milliers, des centaines de milliers survivront. Je ne suis pas pire qu’eux : moi aussi je vais survivre ! Donc, cette volonté de survivre, on se la transmettait l’un à l’autre. Nous prenions soin les uns des autres. Ca représentait beaucoup.
-
 La deuxième règle de survie
La deuxième règle de survie

Source: Entretien réalisé en Hongrie, le 06/06/2009, par A.-M. Losonczy & David Karas.
Licence CC BY-NC-ND
ЗакритиLa deuxième règle de survie
La deuxième règle… on doit percevoir les petits plaisirs de la vie. La souffrance vient toute seule, il ne faut pas la chercher. Les petites joies, par contre, il faut les chercher, les percevoir, les savourer ; c’est l’art de la vie. On m’a rétorqué en me demandant quels petits plaisirs pouvait-il y avoir dans un lager. Je vais prendre un exemple… C’était le défrichage. Et à moins de -20°C, on ne nous emmenait pas travailler dans la forêt. Non pas qu’ils nous préservaient, mais selon le règlement soviétique, les chevaux ne pouvaient pas sortir en dessous de cette température. Or, c’étaient eux qui tiraient les charrettes chargées de bois. Si les chevaux ne pouvaient pas sortir, les prisonniers pouvaient aussi rester dans les baraques. Mais à -15°C, on nous emmenait encore. Au portail, il y avait une zone neutre. Les gardiens aux épaulettes bleues nous fouillaient dans le camp, puis nous mettaient dans la zone neutre d’où les soldats aux épaulettes rouges nous conduisaient en forêt. La fouille consistait à devoir ouvrir complètement notre veste matelassée pour voir combien d’avions à réacteur nous avions sous les bras. Mais si le gardien oubliait d’enlever ma chapka pour voir combien de bombes atomiques j’avais en dessous, quelle joie ! Parce que pendant qu’il les cherchait, j’aurais pris sérieusement froid. Nous devions apprendre à percevoir les petites joies et nous l’apprenions en jouant. C’était l’année des Jeux Olympiques à Helsinki. Et là un premier tour, un deuxième tour et la finale. Nous aussi le matin, en allant à la forêt, nous cherchions les petits plaisirs et le soir, après avoir mangé la soupe au chou, celui qui pouvait en raconter le plus gagnait le premier tour. Au deuxième tour, il y avait les gagnants du premier tour et puis le champion « olympique » que nous fêtions. Bien sûr, nous n’avions rien… mais vous savez comment on faisait ? On lui demandait quelle était sa chanson préférée et nous la lui chantions. Il faut être imaginatif dans cette misère, lorsqu’on a rien. Nous avons eu une fois un champion olympique qui avait réussi à énumérer 16 petits plaisirs. Il nous a dit : « les gars. Aujourd’hui, je n’ai pas eu le temps de souffrir ; toute la journée, je devais guetter les petits plaisirs et me les répéter pour que je puisse vous les énumérer ». Ce n’est pas si facile de se souvenir de 16 petits plaisirs. Donc, c’était terriblement important.
-
 La troisième règle de survie
La troisième règle de survie

Source: Entretien réalisé en Hongrie, le 06/06/2009, par A.-M. Losonczy & David Karas.
Licence CC BY-NC-ND
ЗакритиLa troisième règle de survie
La troisième règle… elle est plus difficile à expliquer parce qu’elle concerne les prisonniers politiques. Les prisonniers politiques ont une déformation professionnelle : ils se croient toujours innocents. J’avais des codétenus, massacreurs issus des Croix Flechées (mouvement fasciste hongrois) qui adorait Szàlasi (leur leader), massacraient les Juifs mais ils faisaient ça par fanatisme et se considéraient innocents. Alors, cette phrase « moi, innocent, que ces salauds armés veulent détruire » n’avait là-bas aucun sens. Il y avait les quatre miradors avec des mitrailleuses pointées, nous étions à 2500 kilomètres de notre pays. Nous ne pouvions fuir nulle part. Il fallait oublier la dichotomie d’innocents et de salauds. Et passer à autre chose ; ce n’était pas facile. Mais en dix ans, on avait le temps. Petit et faible, grand et fort. Quand le tribunal militaire nus a condamné à Budapest, nous n’étions personne, nous étions des vaincus et eux, les vainqueurs. Je ne dis pas que le critère de la vérité est la mitraillette, mais c’étaient eux les vainqueurs et ils nous ont écrasés. Et j’ai dit à mes compagnons : « les gars. Tout ça, c’est une donnée… si je suis un sentier dans la forêt, je ne regarde pas sous mes chaussures pour voir si j’ai écrasé une fourmi. Pourquoi le ferais-je ? Elle est si petite. Mais si je ne suis pas d’accord d’être une fourmi devant ces soldats armés, alors c’est dans ces circonstances et dans cette situation que je dois montrer que je suis meilleur, j’ai plus de valeur et je suis plus noble qu’eux. C’est ce qui mobilise les énergies nécessaires à la survie. petits plaisirs. Donc, c’était terriblement important.
-
 Le dernier jour de travail au camp
Le dernier jour de travail au camp

Source: Entretien réalisé en Hongrie, le 06/06/2009, par A.-M. Losonczy & David Karas.
Licence CC BY-NC-ND
ЗакритиLe dernier jour de travail au camp
Je dois signer ce papier. C’est notre rapatriement. Ce mot, nous ne l’avions pas encore entendu. Ce n’est pas une réhabilitation, ce n’est pas une amnistie, mais un rapatriement, qu’ils nous laissent rentrer chez nous. Je dois l’avouer : nous ne sautions pas de joie parce que nous savions que quand l’Union Soviétique promet quelque chose, il n’en sera rien. Mais il fallait qu’on signe… et pendant que nous signions – 88 personnes ne signent pas un papier en une minute, c’était assez long – la porte s’ouvre et le directeur de la fabrique de meuble rentre. Un homme très important. Il criait, il jurait, il hurlait qu’on voulait le ruiner car, disait-il, si ces 7O personnes ne viennent plus travailler demain – on nous avait dit que nous ne devions pas aller travailler le lendemain – alors il ne pourrait pas réaliser le plan du 3ème trimestre et la prime trimestrielle sauterait et si elle saute, il n’y a plus de prime de fin d’année. Je ne sais pas si vous êtes au courant mais sous le régime communiste, chez nous aussi, la réalisation du plan et même son dépassement étaient leur Dieu. Nous, là-bas, on comprenait ça. Nous nous sommes regardés. Moi aussi je faisais partie de la délégation de 3 membres qui s’est approchée de cet homme si influent: « nous comprenons votre détresse (misère). Ils veulent vous ruiner. Mais écoutez… Nous, prisonniers hongrois, garantissons votre prime. Nous acceptons volontairement ces 6 jours pour que vous l’obteniez. Il n’y croyait pas ses oreilles ! Dans les 40 ans d’histoire de l’Union Soviétique, rien de semblable n’était arrivé. On peut sentir à quel point… nom d’un chien ! nous allions montrer qui nous étions! On nous a cogné mais la confiance en soi… ce genre de chose était très important… En fait, pour être sincère, après 10 ans de travail forcé, 6 jours, ce n’est pas un si grand sacrifice. Mais pour la confiance en soi, pour l’estime de soi, ça avait énormément de sens. Pour résumer, on ne doit pas se plaindre, on doit percevoir, prendre conscience des petits plaisirs, on ne doit pas dire à priori « je suis supérieur » mais montrer le moment venu qu’on est à part. Vous le sentez, n’est-ce pas ? Tout ça c’est l’énergie de la survie.
-
 Libres!!
Libres!!

Source: Entretien réalisé en Hongrie, le 06/06/2009, par A.-M. Losonczy & David Karas.
Licence CC BY-NC-ND
ЗакритиLibres!!
Nous avons fait nos adieux aux policiers. Ils nous ont emmenés à la gare. Nous avons présenté nos papiers au guichet pour qu’ils soient tamponnés. C’est là où nous nous sommes posés la question : « comment peut-on vivre comme ça ? Sans chien de garde, ni soldat armé à côté de nous… ». Vous savez, en 10 ans, on prend l’habitude de cet autre type de vie. On se sentait tout nu. Et nous nous sommes dit, les six : « parlons en russe… parce que dans le train, ils vont nous poser des questions. » Nous étions habillés comme des prisonniers russes. Mais ensuite, quand nous sommes arrivés à Debrecen… il faisait nuit, on était le 25 novembre et à cette période, il fait noir dés 3-4 heures. Là, nous nous sommes dit : « on va quand même parler hongrois parce que si dans le noir, quelqu’un nous file une grosse baffe, c’est parce qu’il croira que nous sommes russes.