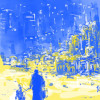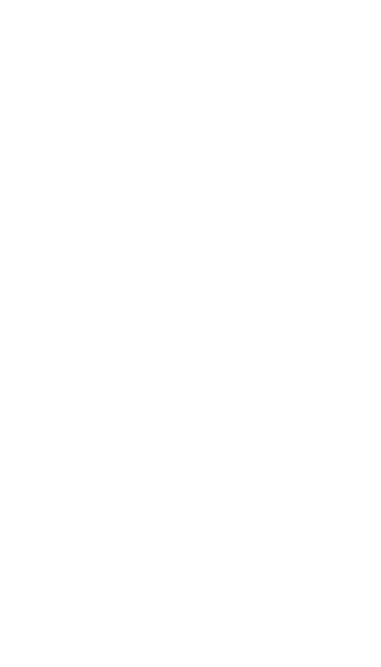BioGraphie
Klara HARTMANN
Klara Hartmann naît en mai 1930 à Miskolc, dans le nord de la Hongrie, de parents paysans, morts très jeunes dont elle n’a aucun souvenir. Elle est élevée par un oncle, sous-officier de gendarmerie à Gönc. Devant l’avancée de l’armée Rouge en janvier 1945, son oncle et sa tante s’enfuient en la laissant seule.
Arrêtée, elle est interrogée et torturée pendant presque une année dans la prison de Kiev, puis condamnée pour espionnage au profit des Allemands à 10 ans de travaux forcés. À Vorkuta, elle travaille dans la construction. Harcelée par les détenues soviétiques de droit commun, elle est emmurée dans sa solitude, sans aucun autre Hongrois dans le camp.
Dès 1949, transférée au Steplag du Kazakhstan, destiné uniquement aux détenus politiques, elle connaît l’entraide et la solidarité dans une brigade majoritairement ukrainienne. En été 1953, après la mort de Staline, c’est à Kiev, sur la route du retour vers la Hongrie qu’elle fait la connaissance de son premier mari, jeune paysan hongrois, libéré comme elle. Elle, qui n’a plus de famille, recommence sa vie dans son village à lui, au nord-est de la Hongrie. Après son divorce, elle travaille sur divers chantiers de construction, le stigmate du goulag ne lui permettant pas d’entreprendre des études. C’est grâce à un médecin du travail qu’elle finira par devenir infirmière et travaillera dans une clinique pour déments.
Remariée, elle qui ne peut pas avoir d’enfants élèvera le neveu orphelin de son mari et deviendra grand-mère. «C’était comme une école. Mais une école très amère» dit-elle, en juin 2009, de ses années dans le goulag.
L'entretien avec Klara Hartmann a été conduit en 2009 par Anne-Marie Losonczy.